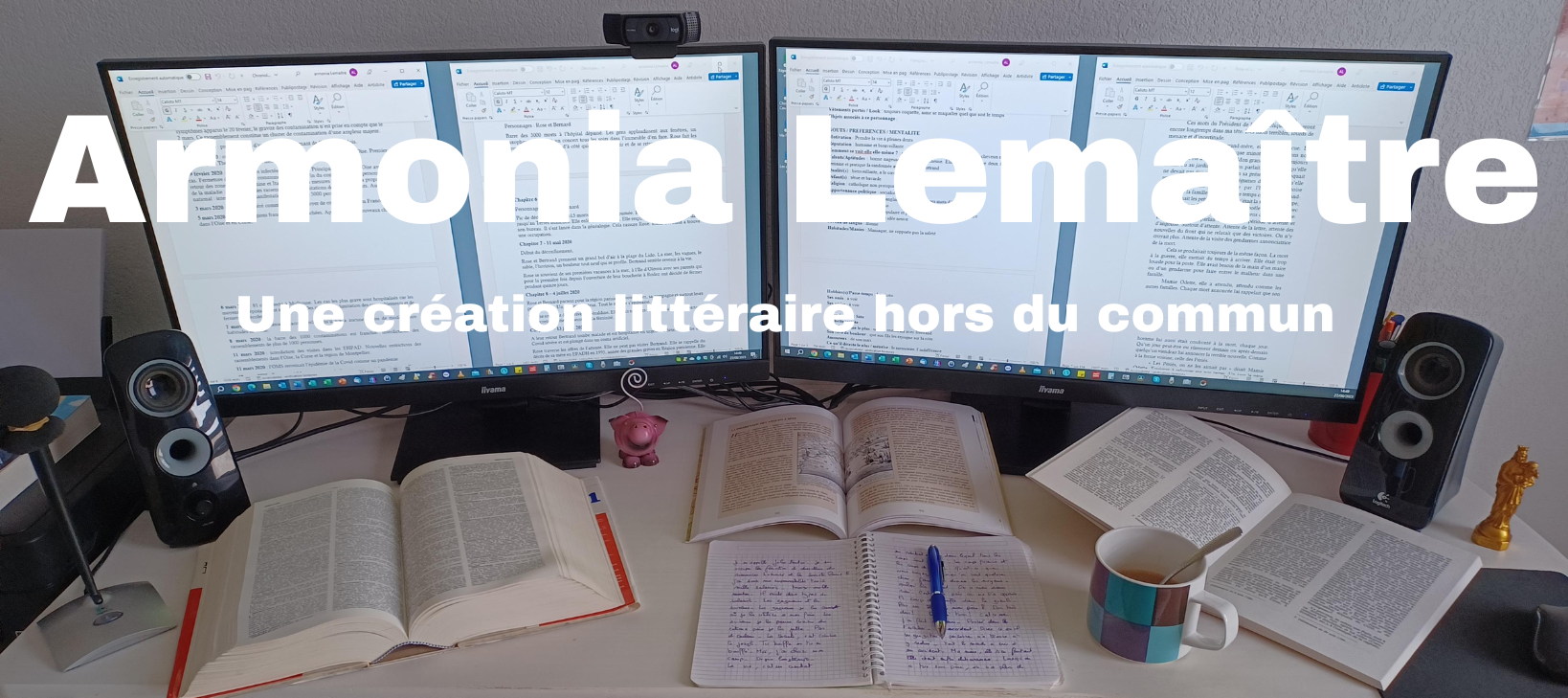Cette nouvelle répond à l’appel à texte de La nouvelle George Sand dont le thème était Grain de sable. Cette histoire illustre la lutte des femmes pour se libérer des normes patriarcales.
On l’appela « grain de sable » tant sa tête était petite. Lorsque Louise, la mère d’Élise, avait accouché sur la table de la salle à manger, lorsqu’elle avait pris le nouveau-né dans ses bras, elle s’était écriée : « Mon dieu, un monstre ! » Élise était la cadette d’une fratrie de dix enfants. À la ferme, après la guerre de 70, la vie avait repris ses droits. Le père, Fernand avait perdu le tirage au sort et il n’avait pas eu les moyens d’acheter un remplacement. Il était mort au combat. Mais, heureusement, son jeune frère Augustin avait eu plus de chance et il ne laissa pas sa belle-sœur dans le besoin. Il l’épousa. Élise était le fruit de cette union. La naissance de cette enfant difforme fut un mauvais signe pour Louise. Elle prit peur. Elle pensa que Dieu se vengeait, parce qu’elle avait convolé avec le frère de son défunt mari.
Élise fut rejetée par ses parents et grandit presque toute seule. Elle poussa comme une herbe folle. Ses cheveux se développèrent en abondance et sa petite tête disparut sous une tignasse hirsute et châtain clair. Ses parents n’estimèrent pas utile de l’inscrire à l’école. Dans une tête si petite, il ne doit pas entrer grand-chose se dirent-ils. Pas la peine de l’encombrer. À dix-sept ans, Élise était devenue une jeune fille intelligente, espiègle et aventureuse. Sa salle de classe, s’était la forêt et ses trésors. Elle en connaissait les moindres recoins. Ses camarades, s’étaient les arbres. Elle leur parlait comme à des amis et leur assemblée toujours fidèle célébrait chaque jour la beauté spontanée et resplendissante d’Élise.
Elle aimait par-dessus tout un petit coin de paradis, connu d’elle seule. Elle devait s’enfoncer profondément dans le fouillis inextricable de la végétation pour y accéder. Une sorte de lagon alimentée par une source d’eau claire courant joyeusement le long d’un talus de mousse et de fleurs multicolores trop heureuses de trouver là un breuvage permanent. Elle avait aménagé un espace, étalant des fougères qu’elle renouvelait régulièrement. Elle s’asseyait de longues heures comme sur un tapis confortable. Elle pouvait ainsi à loisir s’émerveiller en observant la nature prospère et imprévue. Les grandes libellules bleues arpentaient la mare en tous sens et dessinaient une géométrie mystérieuse. Une multitude de nèpes bondissaient en formation comme des soldats montant à l’assaut. Le parlement des grenouilles assourdissait les berges de leurs croassements rauques. Les coroles jaunes des nénuphars émergeaient au début de l’été et leurs feuilles en forme de cœur offraient aux batraciens des promontoires pour la chasse aux petits insectes. C’était un ballet incessant de jaillissement et de plongeons qui faisaient rire Élise aux éclats. Parfois, un timide chevreuil s’enhardissait afin de s’abreuver et s’enfuyait au moindre soubresaut de ce foisonnement désordonné. Les saules caressaient doucement la tête d’Élise de leurs branches comme en hommage à sa plastique si singulière. Elle s’habillait d’une blouse en lin qu’elle lavait dans l’eau de la mare et qu’elle étalait au soleil. Sa nudité innocente resplendissait alors. Elle se couronnait de tige de roseaux et de violettes sauvages. Élise était la reine de ce domaine où régnait la loi parfois cruelle, mais toujours harmonieuse de la nature. Un éden dans lequel la féminité exquise d’Élise rayonnait.
Un matin de juillet, Elise rejoignit, comme à son habitude, son jardin secret après s’être délecté de pommes et de framboises qui croissaient sur le bas-côté d’un chemin creux forestier. En arrivant à la mare, elle s’aperçut que son espace aménagé était occupé par ce qui semblait être un homme. Elle n’en avait jamais rencontré habillé de la sorte. Il était vêtu d’une veste en tergal côtelé, d’un pantalon de toile, de sandales de cuir et d’un chapeau informe à larges bords. Il était assis sur un minuscule tabouret et devant lui, une espèce d’escabeau soutenait un carré tout blanc sur lequel il appliquait des tâches de couleur à l’aide de petits bâtons. Élise observa l’intrus. Elle n’était pas fâchée, mais curieuse de cet homme au comportement si singulier. Que pouvait-il bien faire ? Elle ne se montra pas et déguerpit après quelques minutes. Dans sa fuite, elle fit craquer une branche. L’homme se retourna. Son visage apparut alors. Il était fin et pâle. Un nez légèrement épaté, mais bien proportionné soutenait de petites lunettes rondes de myope qui grossissaient, de façon comique, deux yeux verts. Des joues creuses prouvaient qu’il ne devait pas manger à sa faim tous les jours. Une moustache prolongée d’une barbichette aux boucles folles et brunes achevait de donner à ce faciès une physionomie étrange. On n’aurait pas su déterminer s’il s’agissait d’un fou ou d’un génie. L’homme se nommait Isidore Masnot, peintre de son état. Il arpentait la campagne berrichonne en quête de points de vue pour ses œuvres qui se vendaient mal. Le dernier salon des impressionnistes avait eu lieu en 1886, mais Isidore avait été refusé, encore une fois. Si les papes de ce mouvement artistique étaient maintenant adulés, d’autres, plus obscurs et moins talentueux végétaient. Le marché avait pris le pouvoir. Se faire un nom était devenu une tâche presque impossible.
Isidore Masnot cherchait obstinément le paysage qui lui procurerait de quoi vivre décemment. Il n’aspirait pas à une gloire inaccessible, mais à une existence confortable et paisible. Son frère cadet Arsène avait, quant à lui, senti le vent tourné. Il s’était aussi essayé à la peinture, mais s’était rapidement rendu compte qu’il n’avait ni talent ni coup d’œil. Il s’était donc lancé dans le commerce d’œuvre d’art et était devenu un expert reconnu et redouté. Il avait le don de flairer le succès que pourrait rencontrer un tableau. Une capacité rare qu’il avait acquise en arpentant les musées, les ateliers d’artistes réputés ou ignorés, en écoutant les commentaires des amateurs, en lisant la presse spécialisée, en se fiant à ses propres inspirations la plupart du temps infaillibles.
Il rendait souvent visite à son frère pour le sermonner. « Change de style si tu veux vendre ! » lui conseillait-il. Mais Isidore ne cédait pas et continuait son labeur dans un galetas sous les toits de Paris. Deux petites pièces étriquées et sales. Un matelas posé à même le sol et pour toute cuisine un réchaud à alcool qui dégageait une odeur forte et désagréable. Une fenêtre ouvrant sur la forêt inextricable des cheminées fumantes de Paris. Des centaines de tableaux retournées, que personne ne voulait, parsemaient les murs de son logis. Ils pourrissaient dans ce taudis humide en été et surchauffé en hiver par un méchant poêle à bois. Souvent, lorsqu’il n’avait plus le sou pour acheter des bûchettes, il brûlait des cadres. Il enroulait les toiles et les entreposait dans un coin. Il y en avait déjà plusieurs dizaines. De temps en temps, il effectuait quelques commandes pour survivre. Des portraits où des extérieurs de maison pour de riches particuliers, des bourgeois avares qui avaient fait fortune dans l’immobilier sous le Troisième Empire et qui le payaient chichement. Lorsqu’il avait assez d’argent ou qu’il avait vendu une œuvre à un amateur qui avait bien voulu gravir les six étages de son immeuble, il partait en train vers la campagne française pour chercher l’inspiration.
C’est par hasard qu’il avait déniché cette mare en s’enfonçant au hasard dans les taillis profonds de la forêt. Un lieu inespéré. Il était resté un moment ébloui et son œil d’artiste avait immédiatement flairé le potentiel de ce paysage magique et primaire. Il avait instantanément installé son matériel sur une petite esplanade, fort à propos aménagée, comme à son intention. Lorsqu’il entendit un bruit de craquement derrière lui, il crut à quelques bêtes sauvages et reprit son travail. Il revint chaque jour. Élise aussi. Elle s’approchait à pas de loup et l’espionnait depuis un taillis. Isidore avait senti sa présence par quelques froissements imperceptibles. Il avait compris que cet espace devait servir à quelqu’un et que cette personne était là, à l’observer. Un jour, il se décida en estimant que s’était le bon moment :
— Tu sais, tu peux regarder de plus près. Je ne te ferai aucun mal.
Elise s’enfuit à toutes jambes tant elle craignait cet inconnu. Le lendemain, elle revint et il l’invita une nouvelle fois. Chaque jour, elle s’approcha un peu plus, si bien qu’au bout d’une semaine, elle se tenait debout derrière Isidore.
— Que fais-tu ? Tu voles les couleurs de la forêt, dit-elle d’une voix fluette et claire comme les eaux tourbillonnantes de la source.
— Je ne les vole pas, je les reproduis sur cette toile pour créer une représentation.
— À quoi bon les copier puisqu’elles sont déjà là ?
— C’est pour les partager avec d’autres personnes qui n’ont pas la chance d’habiter à la campagne. Comment t’appelles-tu, jeune demoiselle ?
— Les garnements du village m’appellent « Grain de sable », mais mon vrai prénom est Élise
— Grain de sable ? Quel curieux et gentil sobriquet ! Me permettrais-tu de te regarder ?
— Oui, mais promets-moi de ne pas te moquer de moi comme tous les autres. Ils me jettent souvent des pierres et je dois m’enfuir pour me cacher.
— Je t’en fais la promesse, Élise
Isidore se retourna lentement et contempla la créature qui se tenait devant lui. Il découvrit un corps longiligne aux courbes bien dessinées à peine dissimulées sous une robe de lin froissée, mais qui laissaient deviner des hanches bien pleines, une poitrine dont les aréoles pointaient sous le tissu, des épaules adorables prolongées par des bras menus, un cou gracile qui soutenait une petite tête. Élise le regardait de ses yeux d’un bleu étrange. Son visage parsemé de taches de rousseur respirait la santé avec ses lèvres délicates aux précieux ramages, ses joues dorées par le soleil, deux minuscules oreilles comme deux fleurs aux contours mordorés et un fouillis de cheveux châtain clair. Isidore était ébloui par cet être fabuleux. Il crut un instant à une fée. Son œil aguerri détecta immédiatement le potentiel extraordinaire de cette créature apparue telle une nymphe sortie des eaux.
— Voudrais-tu poser pour moi, chère enfant ?
— Tu promets de ne pas me faire de mal, répondit Élise qui trouva soudain l’idée amusante.
— Je te le promets sur la tête de ce que j’ai de plus cher au monde. Pourrais-tu retirer ta robe ?
Élise qui était l’innocence même s’exécuta et découvrit son merveilleux corps de jeune fille. Isidore en eut un frisson. Ce n’était pas celui d’un désir lubrique, mais l’admiration d’un esthète qui n’avait jamais contemplé un modèle aussi parfait et sublime.
Isidore lui prit la main, l’installa devant la mare et se mit immédiatement au travail.
Nom d’une pipe ! s’exclama Arsène. Où as-tu déniché cette beauté incroyable et énigmatique ? Mon cher frère elle va faire ta fortune. Les gens sont avides de nouveautés et de curiosités. Ils sont lassés des bariolages représentant des paysages. Mais cela, mon ami, c’est original, unique et en même temps mystérieux et magique. Tout le monde voudra découvrir cette rareté. Tu dois absolument la ramener à Paris. Je vais vous aménager un appartement dans le 16e et, crois-moi, tout Paris va se bousculer pour acquérir ce tableau et tous les autres qui suivront.
Isidore n’eut aucun mal à emmener Élise à Paris. Ses parents trop heureux de se débarrasser d’une fille impossible à marier la lui cédèrent contre une rente mensuelle confortable. Isidore l’installa dans son logis et lui recommanda de ne pas sortir.
— Le monde est plein de malfaisants qui auraient tôt fait de t’exploiter, de t’exposer dans quelques foires ou cirques pour amasser de l’argent.
Grâce à la publicité faite par Arsène dans les milieux bourgeois, son appartement ne désemplissait pas. Tout Paris défilait. Les messieurs émoustillés par la beauté singulière de cette créature, les femmes animées par un mélange de curiosité malsaine et de jalousie rageuse à l’égard d’un monstre qui faisait courir toute la ville. Ses tableaux se vendaient comme des petits pains. Isidore croulait sous les commandes. Chacun voulait garder un souvenir de cette découverte étonnante et la montrer à ses amis.
Mais bientôt, Élise s’ennuya. Les animaux de la forêt, les arbres lui manquaient. Un jour, Isidore oublia de verrouiller la porte et Élise s’enfuit. De retour, il comprit qu’il avait perdu bien plus qu’un moyen de faire fortune. Il avait laissé échapper, celle qui lui avait redonné goût à la vie, un être à protéger et à chérir. Il se fit bien des reproches, car il n’était pas différent de tous ces montreurs de curiosités qui exploitaient la difformité humaine. Il rechercha Elise pendant des mois arpentant Paris et ses environs, fouillant les cirques, les foires, les marchés, les chapiteaux ambulants. Enfin, à bout de force, il eut l’idée de placarder des affichettes, de faire paraître des annonces dans les journaux, promettant une très forte récompense à qui lui fournirait des renseignements. Cela ne tarda pas. Un homme vint le visiter et lui parla d’un cabinet clandestin de curiosités, rue de Ménilmontant, où il avait vu des monstruosités impensables, dont une femme à petite tête. Isidore se précipita et découvrit son Élise, la tête rasée de près, enfermée dans une cage. Isidore menaça le propriétaire de cet établissement innommable de le dénoncer à la police s’il ne lui restituait pas Élise, car ses « pensionnaires » étaient traités d’une façon immorale et cruelle. L’exploitant céda et Isidore put ainsi délivrer Élise
Arrivé chez lui, il fit cette promesse :
— Maintenant que te voici retrouvée, je jure devant Dieu de ne plus jamais t’exposer à la curiosité. Je suis riche grâce à toi et je souhaite te donner mon nom afin que plus jamais tu ne sois dans le besoin. Tu hériteras de mes biens, car je suis vieux et malade. Mes jours sont comptés. Demande-moi ce que tu désires et je l’exhausserai ! Si tu veux retourner dans la forêt, je ne t’en empêcherai pas même si cela me fera beaucoup de peine.
— Je ne veux pas retourner dans la forêt, car j’ai trop souffert de la moquerie des gens et j’ai découvert le confort de la ville. Pendant que j’étais chez toi et en prison, j’ai eu le temps d’observer les dames, car elles sont venues nombreuses pour me visiter. J’ai remarqué qu’elles portaient des chapeaux tous plus horribles les uns que les autres. Je voudrais ouvrir une boutique afin de changer cela.
Cette demande étonna Isidore, mais il reconnut bien là l’intelligence d’Élise. Il mit tout en œuvre pour lui permettre de réaliser son rêve. Il l’épousa puis lui acheta un magasin dans le quartier des Halles. Un vaste espace dans lequel elle pourrait laisser s’épanouir son esprit créatif, étancher sa soif de nouveauté. Élise s’inspira de la forêt et de son petit coin de paradis pour imaginer des modèles tous plus originaux les uns que les autres. Son inventivité était sans borne. Elle avait mis en évidence à l’entrée de sa boutique l’écriteau suivant : des chapeaux pour toutes les têtes, grandes ou petites. Bientôt, toute la bonne société se pressa dans les allées de son magasin. Elle s’enrichit rapidement. Elle embaucha en priorité les « monstres » de Paris notamment ceux du cabinet de curiosités où elle avait été détenue pendant des mois. Pour ceux qui ne pouvaient travailler, elle ouvrit un hospice où ils furent traités avec humanité et pour certains soignés. Elle créa une collection de prêt-à-porter pour les femmes, quelles que soient leurs mensurations. En 1888, c’était absolument révolutionnaire.
Élise devint une égérie de la mode et son enseigne brilla au firmament des entreprises pionnières. Elle lui donna le nom qui l’avait longtemps poursuivi comme une malédiction : Grain de sable.