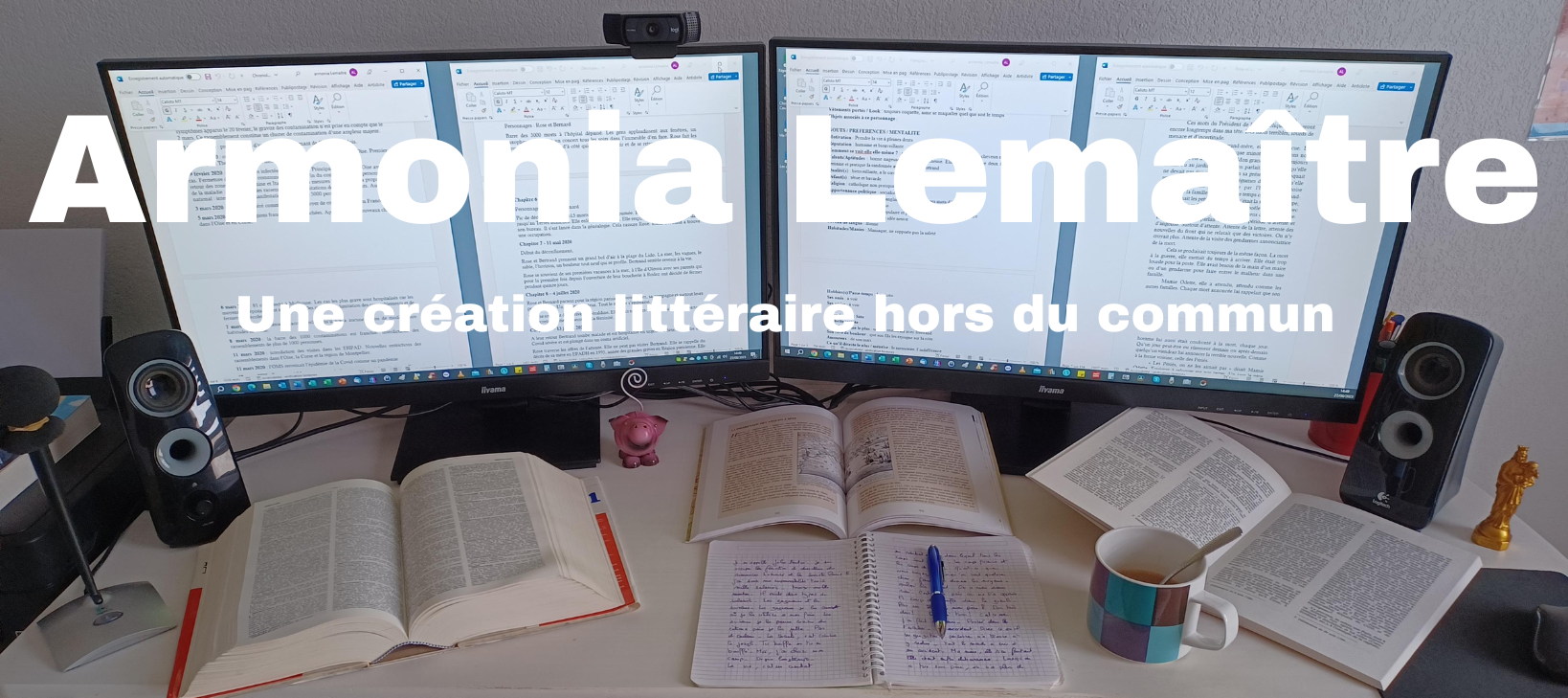Une amie a publié, sur un célèbre réseau social, la déclaration suivante : « J’ai envie d’écrire une petite histoire, mais les mots ne viennent pas ». Cette petite phrase à première vue anodine est d’une grande importance, car elle interroge notre rapport à l’écrit. On pourrait se demander ainsi : puisque cette amie a « dans la tête » une petite histoire pour quelle raison ne la traduit-elle pas immédiatement en texte, en phases, en mots. Autrement dit : qu’est-ce qui empêche les mots de lui venir ?
Il m’est arrivé aussi fréquemment de rester improductive devant mon écran d’ordinateur et j’ai tenté d’analyser ce phénomène bien connu de « l’angoisse de la page blanche ». Dans cette expression, il y a « angoisse ». Serait-ce donc l’angoisse qui nous paralyserait devant la tâche à accomplir. Quelle serait la raison de cette peur ? En d’autres termes : de quoi avons-nous peur ? Que symbolise cette association de mots : l’absence totale d’inspiration, le trou noir ou blanc, le vide, la mort. La page blanche c’est la mort symbolique de l’écrivain. Sans le noir des mots sur la page blanche, l’auteur ne produit plus donc n’existe plus. L’angoisse de la page blanche, serait-elle donc la peur de la non-existence, de la mort de l’écrit qui signifierait pour l’écrivain sa disparition pour les lecteurs ? Certes oui, car l’écrivain n’existe que parce qu’il est lu et acheté, mais ce n’est que la conséquence de l’« angoisse de la page blanche » et cela ne dit rien sur ses causes profondes. Car ce désarroi, cette impossibilité de traduire en mot une pensée, une image ou une histoire comme le soulignait cette amie va bien au-delà de cette peur. Elle peut saisir chacun d’entre nous face à l’écrit, quels que soient l’intention et le statut de cet écrit. On peut écrire uniquement pour soi (un journal intime) ; écrire pour quelqu’un (une lettre ou un mail) ; écrire pour un cercle d’amis ou pour un plus grand nombre de personnes (un poème ; un récit, une nouvelle, un roman, un essai ou toute autre production littéraire, journalistique ou scientifique.). Quel que soit ce que l’on écrit, on peut être saisi par cette impossibilité de trouver les mots pour traduire une idée, raconter une histoire ou simplement s’adresser à quelqu’un. « Je ne trouve pas mes mots » est une expression bien connue et qui traduit cette difficulté à exprimer. Tout en écrivant ces mots, je suis moi-même assaillie par cette sensation parce que j’ai peur de ne pas trouver mes mots, de ne pas réussir à exprimer le plus justement possible ce que j’ai dans la tête.
Lorsque j’écris ou que je tente de le faire, je suis face à moi-même, mes fêlures, mes blessures, mon histoire et aussi mon état psychologique et physique. Cette confrontation est parfois éprouvante, car écrire est une épreuve solitaire, une course de fond. Il m’arrive ainsi de devoir reprendre ma respiration, faire une pause, car je suis épuisée. Mon esprit autant que mon corps me crient stop. J’éprouve alors une grande frustration de laisser ma page inachevée. J’ai peur du vide. J’ai peur de perdre mon histoire ou la magie, l’alchimie de l’inspiration.
L’écriture contient en soi sa finitude, notre finitude. J’écris pour l’autre, pour les autres pour laisser quelque chose, une trace, une empreinte lorsque je ne serai plus là, lorsque je serai morte. Ne pas pouvoir traduire sur le papier, ce petit morceau d’éternité me renvoie à ma condition de mortelle. En voulant durer par l’écrit, je mets en même temps le doigt sur l’inéluctabilité de ma fin. L’écriture est éternité, mais aussi mort, la mienne, la nôtre. Regarder cela en face n’est pas toujours évident.
À cette amie, j’ai conseillé deux moyens de sortir de cette difficulté.
Comme elle avait cette histoire dans la tête, je lui ai proposé de se la raconter à elle-même dans sa tête et ensuite de l’écrire comme elle l’avait pensé. Car l’écriture est d’abord un récit que l’on se fait à soi-même, sans l’écrire. Pour ma part, je n’écris pas tout le temps. En revanche, je pense très souvent à mon histoire, ses péripéties, mes personnages. Beaucoup pensent que, pour construire un roman ou une histoire, il faut forcément l’écrire, tout de suite, y passer des heures et des heures. Cela ne fonctionne pas toujours comme cela. Il est souvent nécessaire de ne pas écrire, de dormir. J’écris beaucoup mieux après plusieurs jours, plusieurs semaines, après de longues périodes de sommeils pendant lesquels mon esprit remet ses idées en place, les organise.
Écrire une histoire comme on l’a pensée, cela peut être aussi, s’octroyer la liberté de mal écrire. L’écriture est liberté ou n’est pas. On a peur de la page blanche parce que souvent la page est un ennemi, qui synthétiserait toutes nos frustrations, nos traumatismes liés à l’école, à l’apprentissage de la lecture, de l’écriture, des savoirs. Écrire cela signifie : s’octroyer la liberté d’écrire mal, car peut naître de cette imperfection, un style, une modernité, une nouvelle façon d’écrire, un nouveau roman. Je revendique pour ma part la liberté d’écrire comme on le veut, de se libérer des conventions, des pesanteurs, des carcans qui paralysent les plumes et empêchent certaines personnes de s’exprimer. Finalement, l’angoisse de la page blanche est une chance. Une énergie qui ne demande qu’à s’épanouir, la prémisse d’une résurgence, d’une exhumation de quelque chose que l’on avait déjà en soi, mais que l’on empêchait. Je crois beaucoup aux vertus de l’écriture automatique et je l’ai beaucoup pratiquée.
Une façon de dépasser cette angoisse, c’est aussi faire preuve de bienveillance et d’humilité. Nous sommes les premiers juges de notre production. Mes premiers jets sont rarement de bonnes factures. C’est souvent inabouti. Mais, qu’importe ! Notre écriture est un miroir. Ce que nous voyons n’est pas ce qui est, mais la façon dont nous le voyons. Il est nécessaire de s’en détacher pour mieux l’apprécier, ne tomber ni dans la détestation ni dans l’adoration qui sont les deux mêmes faces de l’aveuglement. L’angoisse de la page blanche peut être ainsi vue comme quelque chose de salutaire. Je me méfie de trop d’enthousiasme, de trop de ferveur, de fièvre, car cela entraîne parfois une vision déformée de sa propre production, une adoration injustifiée. Écrire c’est aussi jeter, beaucoup jeter. Il ne faut pas avoir peur du vide de la page blanche. Dans le vide, il y a toujours quelque chose en gestation.
Je dirais en conclusion que la page blanche n’est pas une ennemie, mais une alliée de notre inspiration, une promesse, une œuvre en devenir. Elle symbolise, à elle seule, la liberté de créer !